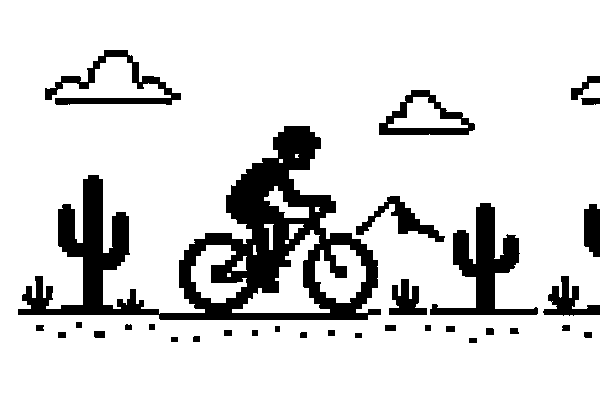Un voyage en Italie : le Val Maira, la vallée perdue en vélo
Par Pierre Pauquay -

Les montagnes sont de formidables forteresses qui renferment la culture et les traditions de tout un peuple. En Ubaye comme en Queyras, ces deux territoires ont une identité forte, forcément belle. Mais qu’en est-il de l’autre côté de la frontière, dans ce Piémont italien où se blottit une vallée méconnue et isolée, le Val Maira ?
Depuis que nous avons découvert son nom, cette région cachée de l’autre côté de la montagne a attisé notre curiosité de voyageur. Pour préparer notre itinérance, il fut difficile de trouver des infos sur la vallée : les éditions de topo-guides ou les commentaires d’itinéraires ne sont guère légion.
En France, les cartes de l’IGN sont détaillées, fourmillent de détails jusqu’au dessin de la frontière italienne. Au-delà, c’est l’approximation qui domine. Les zones montagneuses deviennent terra incognita. Au début des années 2000, l’IGN et son penchant italien, l’Instituto Geografico Militare, avaient édité, grâce à des fonds européens, une série de cartes couvrant le territoire frontalier de Nice au lac Léman. Par chance, nous avons trouvé celle qui englobe la région du Chambeyron et du Val Maira. Un bel assemblage de cartes qui va remédier aux lacunes concernant cette zone frontalière. La représentation du terrain semble assurée et le tracé des chemins paraît fiable. Nous voilà prêts pour un beau voyage.
Isolement
L’envie était trop forte de franchir la frontière et de rouler là-bas en itinérance dans ces paysages fantômes avec mon compagnon de voyage, Christophe. Depuis Barcelonnette, la route qui mène à Maljasset, dernier hameau cul-de-sac de la Haute Vallée de l’Ubaye, se rétrécit au fur et à mesure de notre avancée, comme si elle voulait protéger cet écrin qui n’a guère subi les affres de la modernité ; ici, point d’aménagements pour le ski ou de constructions modernes.
Des générations entières ont vécu en totale autarcie, loin du développement que connaissaient alors les vallées voisines. En hiver, Maljasset était isolé du monde extérieur durant près de 8 mois. Dans le village, on se serrait les coudes, à attendre la belle saison.
Vallis Montis
L’Ubaye est une rivière qui s’étend sur 80 kilomètres jusqu’à son embouchure avec la Durance au lac de Serre-Ponçon. La Haute Vallée ou la Vallis Montis, l’ancienne vallée des Monts est étroite et cernée de cimes dépassant les 3.000 mètres d’altitude. Des sommets imposants mais jamais écrasants.
Au vu du paysage, il nous semble que l’accès en Italie est jouable à VTT. Depuis Maljasset, la magnifique église nous salue avant de quitter de suite le fond de vallée qui se dirige vers le Longet : ce col sera, trois jours plus tard, notre passage pour le retour. Le chemin des alpagistes ne dure guère : face à nous se dresse déjà le premier ressaut. Il sera également la plus grosse difficulté de la journée à franchir. VTT sur le dos, nous entamons le premier portage. Et il rappelle que son ennemi principal, c’est le poids. Cette fois, pour ce voyage en Italie, nous emportons des VTT semi-rigides, plus légers et plus simples.
D’un côté, mon fidèle Santa Cruz Chameleon et pour Christophe un Rockrider fourni par la rédaction, le XC 500. Il vont se montrer tous les deux d’excellentes machines pour affronter ce voyage. Les sacoches typées « bikepacking » se limitent à l’une située derrière la selle et l’autre installée sous le tube horizontal : un placement qu’autorise la géométrie du cadre semi-rigide. Le choix est minimaliste puisque nous n’emportons pas de tente et de duvet : nous logerons soit dans des gîtes, soit des Agriturismo.
Passage en Italie
La longueur du vallon du Mary nous permet d’entrer au cœur de la montagne. La lecture de la carte est importante ; nous choisissons les sentiers qui traversent des courbes de niveaux pas trop serrées les unes par rapport aux autres, ce qui devrait augurer des ascensions à VTT. Et le vallon du Mary est la clé pour passer en Italie.
Dans le val du Mary, l’homme est parvenu à exploiter une carrière de marbre au milieu du XIXe siècle. Les blocs, coupés, étaient acheminés par des charrettes vers Saint-Paul. Un travail de forçats qui a néanmoins permis d’ériger les monumentaux escaliers de l’Opéra de Paris…
Sur le sentier, il y a peu de mondes : nous roulons seuls sur cette terre qui ne cesse de s’avancer vers le sud. Les alpages se tapissent de fleurs ; nous sommes à la mi-juillet et la belle saison vient juste de débuter. Les moutons n’ont pas encore rejoint leurs quartiers d’estive. Dans le ciel, un petit faucon nous salue avec son vol caractéristique et les marmottes, maigres suite à leur longue hibernation, s’égayent dans tous les sens. Alors que nous approchons du col du Mary, de grandes dalles forment un magnifique chemin en altitude : ce col fut sans nul doute un lieu de passage important entre le Piémont, dépendant du Duché de Savoie et le Royaume de France.
Au col, une madone ouvre en grand ses bras au ciel : nous basculons du côté italien. Et là, c’est le choc. Le paysage change du tout au tout. La pente débonnaire, côté français, devient verticale. Le doux alpage se mue en roc. La montagne est tranchante, ciselée, brute. Entre le Monte La Ciarm et le Monte Cerello, le sentier se fraye un passage, se tortille mais jamais nous ne mettrons pied à terre. Grâce à leur poids contenu, nos VTT se faufilent entre les rochers et les pierriers sans faillir.
Le plaisir de pilotage reste intact. Au fil de la descente, l’univers de la pierre et du rocher se montre plus hospitalier. Les premiers alpages et les premiers lieux de vie apparaissent. Le sentier devient un chemin puis une piste que nous dévalons rapidement car les nuages deviennent menaçants. Derrière-nous, au col, l’orage gronde déjà. En montagne, il vaut toujours mieux traverser un col en matinée…
Le charme à l’Italienne
Dans une lumière de fin du monde, nous arrivons à Chiappera, quel joli nom ! Il pourrait être ce paradis que tout montagnard rêverait pour y vivre. Dans ce hameau cul-de-sac raisonne toute la beauté du mariage de la pierre et de la nature environnante. Avec en toile de fond le Monte Castello dressé comme une obélisque, chaque bâtisse est décorée avec goût. Nous posons nos sacs à l’Agriturismo, la Provenzale : quel luxe que de prendre du bon temps après cette première journée.
Le deuxième jour, la progression dans le Val Maira va s’apparenter à une expédition dans le grand vert. De Chiappera à Acalgio, un sentier en balcon offre une vision sur l’enfilade de la vallée. Sa profondeur est telle que nous avons des difficultés à distinguer son fond où coule la rivière Maira.
Notre itinérance suit les pistes et les routes carrossables qui relient les hameaux perdus. Les noms chantants de Colombata, Chioligiera ou Ussolo témoignent d’une présence humaine dans ce milieu hostile. Au détour d’un virage, une sente s’envole vers le haut. De portages en escaliers naturels, la trace devient difficile, éprouvante techniquement et physiquement. Nous avons l’impression d’ouvrir le sentier tant il se recouvre d’herbes hautes, d’orties et de ronces.
Expédition dans le grand vert
Nous sortons du vert quand apparaissent les crêtes sommitales du col Serasin. Chaque virage est une invitation à la contemplation. Si en basse altitude l’eau a créé des gorges profondes, en altitude, les versants doux et ensoleillés sont parsemés d’une multitude de quartiers de maisons en pierre qui témoignent du lien qui existe entre l’homme et la montagne. Elles sont désormais silencieuses et parfaitement intégrées dans le paysage.
La pauvreté des ressources fit naître des petits métiers comme les « capellare », ceux qui passaient en hiver au peigne fin ces hameaux pour convaincre les femmes de vendre leurs longs cheveux afin d’en fabriquer des perruques.
La luxuriance de la végétation cache des regards les villages perchés. Si en basse altitude, l’improbabilité du sentier encouragerait à rebrousser chemin, plus haut la forêt de mélèzes ouvre enfin la trace. Nous roulons dans l’immense forêt où nous n’avons aucune idée du temps qu’il nous faudra pour en sortir. La progression est infinie : sortirons-nous de ce dédale ?
Alors que nous roulons depuis plus de deux heures apparaît enfin dans une clairière un petit îlot de vie, le hameau de Castiglione accroché aux flancs de la montagne. Nous remplissons dans la fontaine notre poche d’eau avant de poursuivre vers Elva, la commune aux 20 hameaux. Tous sont disséminés et cachés. Nous rejoignons celui de Cesami via les versants herbeux. L’ascension vers le Colle San Michelle traversant une forêt de mélèzes nous offre la plus belle des traces.
Col du Giro
Peu après Elva, dernier village perché de cette journée, nous voilà au pied d’un des géants du Giro. Le col Sampeyre est l’une des ces ascensions qui ont forgé la légende de la course avec deux passages en 1995 et en 2003. Le mauvais temps s’accroche sur les sommets : nous ne verrons pas face à nous le géant de la région, le Mont Viso flirtant les 3.000 mètres d’altitude.
Trempés de sueur suite à la longue et difficile ascension du col, nous subissons au sommet le froid de l’altitude et les premières gouttes de pluie. Sans prendre le temps de choisir les singletrails techniques de la descente, nous filons tout droit vers Sampeyre, après avoir gravi près de 3500 m de dénivelé ; une journée exténuante où nous avons pu percer une partie du secret du Piémont.
Dans la petite cité, l’accueil est charmant : le français est pratiqué et il nous rappelle que nous sommes dans le pays occitan, cette région linguistique qui court du val d’Aran en Espagne au Piémont, en passant par le Midi.
Pays occitan
Le matin, depuis Sampeyre, la remontée de la vallée passe par un magnifique sentier constellé de fleurs le recouvrant. Depuis le hameau de Foresto, les randonneurs se font rares : il y a peu de passages. Nous forçons la trace sur le seul sentier balisé en nous y lançant à travers les fourrés. A l’époque où la route n’existait pas, il liait les villages les uns aux autres et allait de sources en fontaines. Aux fleurs se succèdent les pierriers et les murets de pierres sèches. Ce sentier est ancestral, historique même quand nous découvrons l’entrée d’une ancienne mine. A la Croce d’Alie, l’itinéraire bascule et descend vers Casteldefino (Château Dauphin en français dans le texte…).
Le sentier ressemble à ceux que l’on croiserait plus volontiers dans les régions arides de France. Les plantes urticantes que nous frôlons avec nos coudes et la caillasse qui roule devant nos roues temporisent nos ardeurs. D’épingle en épingle nous approchons du village. Il est l’heure de midi et tout est fermé, sauf la Meisoun des Ravioles où nous allons goûter à la cuisine piémontaise. Assis devant une table de cantine drapée d’une nappe de carré rouge et blanc, nous nous régalons devant le plat du jour de ravioles. L’espresso ravive le corps afin qu’il puisse gravir les derniers dénivelés vers le pied du col Agnel.
En suivant le cours du torrent, nous aboutissons au barrage de Castello qui fut construit durant l’époque trouble de Mussolini, entre 1935 et 1942. Il fut le plus grand barrage de son époque, atteignant une hauteur de 75 mètres et un rayon de courbure de 250 mètres. 220 000 mètres cubes de pierres concassées et de béton furent nécessaires à son édification.
Retour par le Longet
Longeant le lac, le chemin s’élève hors de la forêt pour rejoindre Chianale, le dernier village italien, situé au pied du col Agnel menant dans le Queyras. En grimpant en altitude, les versants luxuriants du matin s’opposent à ceux plus désolés de la haute montagne.
Le soir, c’est un dernier havre qui nous accueille, celui de l’agriturismo le Pra Mourel tenu par une Française du sud venue vivre dans le village piémontais.
Le retour en France passera par l’ascension du col du Longet, soit un portage quasi ininterrompu. Il s’agit pourtant du seul passage possible pour rejoindre la frontière. Les marches succèdent à de courtes portions roulables ; afin d’éviter les incessants changements de rythme, autant rester à côté du vélo.
Du col, le paysage de la Haute Vallée de l’Ubaye s’ouvre à nos regards. Il ne nous reste plus qu’à nous laisser griser par la longue descente qui passe par les alpages du Longet. Nous avons le sentiment de revenir, comme ces explorateurs, d’un autre monde, du Val Maira et de son exceptionnelle sauvagerie. En parcourant cette itinérance de trois jours, nous aurons rencontré des villages perdus, traversé des montagnes sauvages et touché l’âme piémontaise.
À bientôt l’Italie !